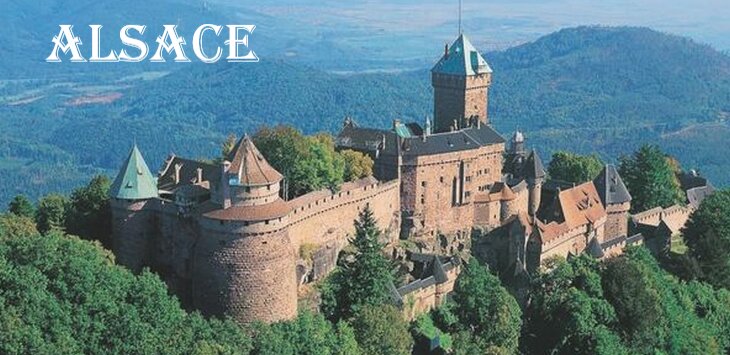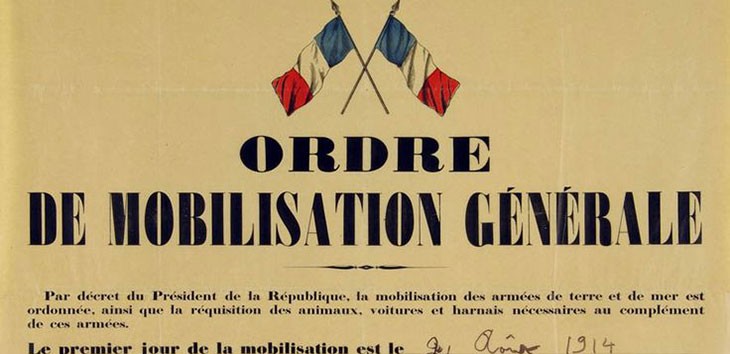J’en avais vu passer des balles durant ces années de guerre jusqu’à cet instant. Il fallait être bien endurci pour ne pas être sensible à tous ces dangers, pour s‘exposer sans relâche jour après jour, mois après mois, année après année aux dangers les plus grands et pour garder calme et raison au cœur même des dangers. C’était la seule manière de s‘en sortir, sans se laisser anéantir. Pour tenir le coup, il était nécessaire de se fixer des règles bien définies et d’agir en fonction de ces règles. En premier lieu, j’examinai toutes les possibilités qui pouvaient se présenter. On pouvait être blessé. J’avais déjà eu deux blessures précédemment et je connaissais bien cette situation où l’on est immobilisé. Il se pouvait naturellement qu’on soit blessé si grièvement qu’il en résulte des séquelles définitives, pour toute la vie. Mais quoi qu’il puisse arriver, je jugeai que la vie était digne d’être vécue sous quelque forme que ce soit.
En second lieu, il se pouvait que l’on ait à redouter d’avoir la malchance d’être fait prisonnier. J’avais moins d’expérience en ce domaine, mais je croyais que la vie pouvait être digne d’être vécue aussi en prison. Là, on pouvait toujours penser à s’évader.
Ce sort, qui offrait la possibilité de travailler à reconquérir sa liberté, me semblait par essence meilleur que le troisième sort qui frappait chaque jour beaucoup d’entre nous : tomber au combat. Mais même là, une seule chose me guidait : regarder tous les dangers en face avec calme, sans crainte ni poltronnerie et au cas où la balle qui m’était destinée, me frappe, affronter l’issue finale avec le sourire.
Quand lors de mon vol de reconnaissance, la nuit, une grenade explosa sous mon avion tout près, c’est le deuxième des destins que je viens d’évoquer qui me frappa : la captivité.
Un explosif devait avoir touché une conduite d’essence, car soudain le niveau d’essence baissa et l’un des moteurs s’arrêta. Nous essayâmes encore d’atteindre le front avec l’autre moteur et le reste de l’essence, mais c’était trop loin et nous n’avions pas effectué la moitié du trajet que l’autre moteur s’immobilisa lui aussi à 500m de hauteur. Au- dessous de nous s’étendait dans le plus grand calme, au clair de lune, une petite ville française, au- dessus de laquelle nous nous dirigions en vol plané vers une belle clairière. Nous atterrîmes calmement, sans causer le moindre dommage à l’avion lors de l’atterrissage. Personne n’avait rien remarqué alors que seul le sifflement du vent dans les haubans aurait pu nous trahir. Mon pilote ne voyait pas très bien où nous étions et me demanda si nous avions atterri côté allemand. Je dus malheureusement lui dire que nous étions encore à environ 50 à 60 km de nos premières lignes. Cette information ne lui fut pas plus agréable qu’à moi, mais qu’elle nous déplaise ne servait à rien, il fallait agir.
Incognito en territoire ennemi
A 60 km derrière les lignes ennemies, sans connaissance des habitudes de l’adversaire, sans connaissance ni pratique de la langue du pays ! En premier lieu, il ne fallait pas que notre avion tombe intact aux mains de l’ennemi. C’était facile à réaliser. Nous avions deux bombes destructrices avec nous. Nous éloignâmes de l’avion tout ce que nous pourrions utiliser dans les jours à venir et nous mîmes à l’abri tout ce qui ne devait pas tomber aux mains de l’ennemi de sorte que ça ne soit pas détruit lors de l’explosion. Nous mîmes les bombes entre le réservoir à essence et les cylindres des deux moteurs et nous tirâmes les manettes d’allumage en même temps. Ensuite, nous prîmes la poudre d’escampette aussi vite que possible.
Nous décidâmes d’essayer au moins de progresser en direction de nos lignes. Avec nos uniformes d’aviateur, nous nous fîmes un costume de randonneur et
la nuit, nous nous mîmes en chemin en direction du nord-est. Nous croisâmes quelques voies ferrées et bientôt nous prîmes la bonne orientation. Nous ne progressions pas très vite, car nous étions angoissés et devions faire attention à
tout être vivant et parfois rester des heures dans les fossés, jusqu’à ce que les bruits que nous avions perçus ,cessent. Au matin, nous nous couchâmes dans un champ de blé pour nous reposer. Quand nous nous réveillâmes après notre premier somme, une faim terrible nous torturait, que nous essayâmes d’apaiser par tous les moyens, mais en vain ; car en cette saison, rien n’avait encore poussé. C’était un merveilleux jour de mai. Le soleil se levait et ses rayons brûlants nous donnaient extrêmement soif, mais nous ne pouvions pas sortir de notre cachette. Nous observâmes tout près de nous des recrues en formation , nous vîmes beaucoup de voitures sur les routes se dirigeant vers le front et nous les suivions par la pensée. Nous dûmes attendre dans notre cachette que la nuit tombe. Ensuite, nous nous remîmes en route et traversâmes Compiègne à minuit.
Nous étions heureux d’avoir passé deux postes et peu à peu, nous fûmes de moins en moins prudents. Avec une lampe de poche, nous éclairâmes un panneau indicateur et nous continuâmes notre route. Un garde français avait vu la lumière de la lampe de poche, il nous cria de nous arrêter.
Capture
Nous ne pouvions pas reconnaître le garde debout dans l’ombre. J’essayai de me faire passer pour un capitaine anglais et lui criai : Capitaine Cook. Nous n’inspirâmes pas beaucoup confiance au garde. Il sortit de l’ombre, vint vers nous et nous fit prisonniers. Il nous fit comprendre que nous devions aller au poste de garde et nous pria d’entrer dans une cour, en empruntant une porte percée dans un mur. Je voyais le garde et voyais, derrière la porte, poindre l’inévitable captivité. Quelques secondes m’en séparaient et c’est au cours de ces secondes que ma volonté se dressa contre cette idée. D’un mouvement poli de la main, je signifiai au garde de nous précéder. Le garde abaissa sa baïonnette et au moment où il voulut passer la porte, je lui donnai un grand coup et partis en courant. Le pilote de mon avion, qui était à côté de moi s’enfuit en courant, dans l’autre direction. Le garde a dû être pas mal touché par mon geste peu aimable, car pendant les dix minutes qui suivirent, je n’entendis rien derrière moi ; mais ensuite ça s’anima et je pressentis qu’on se mettait à nous poursuivre, nous, ces deux grands délinquants. Bien que j’eusse grande hâte de sortir des dernières rues de Compiègne, je dus, avant cela, me contenter d’une vitesse assez lente. Venu de l’autre côté, un soldat avançait dans ma direction, il m’interpela et me demanda le chemin de la gare. Le sens de sa question, je le comprenais bien, mais je ne pouvais pas lui répondre. Je fis d’abord comme si je ne le comprenais pas et restai de l’autre côté de la rue. Comme il répétait sa question, je me retournai en montrant la direction inverse de celle d’où je venais, en disant : « Directemang » C’est la seule chose en français qui me vint à l’esprit à ce moment là . Le soldat, l’air tout à fait mécontent, se mit en chemin et moi, je pris la poudre d’escampette, pénétrai dans un jardin et arrivai dans un champ à la sortie de ce jardin. J’avais échappé à la première capture.
(Capture-) Prisonnier de guerre
Je ne savais pas où était le pilote de mon avion. Maintenant j’étais seul. Je ne considère pas qu’être seul en de telles circonstances est une mauvaise chose, car un homme seul s’en tire plus facilement et peut mieux suivre des idées subites que deux. A deux, il faut d’abord s’expliquer et les quelques secondes que nécessite la compréhension du projet, suffisent, la plupart du temps, à faire échouer des idées qui auraient eu, sinon, des chances de réussir.
Cette nuit, je tombai une nouvelle fois sur une patrouille, alors que je traversais la grand’route. Un employé de la police française me fonça directement dans le ventre, au moment où je voulus traverser la route. Tandis qu’il se remettait lui aussi de sa surprise, descendait de vélo et comprenait vraiment la situation, j’avais déjà disparu à 50m de là dans un champ de blé. A partir de ce moment- là, par crainte, j’évitai toutes les routes et je ne traversai les routes au clair de lune qu’en rampant sur le ventre.
Durant quatre jours j’avançai au prix de maints efforts. La cinquième nuit, j’étais arrivé, par chance, sur la ligne la plus avancée et passai un jour entier, couché dans les cratères creusés par la chute des grenades. Comme du côté allemand on tirait assez violemment et que le feu s’étendait de façon très inattendue sur toute la région, je ne pouvais pas voir grand’ chose de l’occupation des tranchées. Il régnait un silence de mort et l’on n’entendait que le craquement et le sifflement des grenades. Quand vint le soir, l’animation reprit de tous côtés. Peu de temps auparavant, j’étais monté dans un arbre et de longues colonnes passaient au-dessous de moi, à proximité immédiate de ma cachette, elles commençaient à creuser des tranchées pour se protéger. Compte tenu des circonstances, tout se déroulait dans un grand silence. Maintenant le moment était venu de franchir les derniers obstacles, pour parvenir à nos tranchées. Pour ce faire, je devais traverser un chemin creux construit pour servir de position de défense. Alors que je venais juste d’accéder à ce chemin creux, j’entendis soudain des pas à côté de moi. Le « bleu horizon » de l’uniforme français se fondait si bien dans la nuit que je pouvais seulement entendre les gens qui marchaient à côté de moi. Dans l’ombre de la tranchée, baignés par le clair de lune argenté, les gens n’étaient en effet visibles que s’ils étaient tout proches. Une colonne de vingt hommes était déjà passée devant moi et alors, j’entendis le chef de troupe donner l’ordre de revenir en arrière. Les gens à côté de moi répondirent en des termes que je ne peux pas redonner ici. Les gens à côté de moi ne pouvaient pas me voir. J’espérais ne pas avoir à faire de bruit et ainsi échapper au danger d’être découvert. Mais le caporal me tapa sur l’épaule et alors tous me tombèrent dessus, j’étais pris.
16 mois s’écoulèrent entre le moment où je fus fait prisonnier et le moment où je réussis à m’enfuir. Partout où j’étais mis sous bonne garde, toutes mes pensées, tous mes agissements n’avait qu’un seul objectif : m’échapper à nouveau. J’ai planifié et forgé plein de projets d’évasion, en vain.
En passant par les toits, à travers les barbelés et sous terre. Tous étaient condamnés à échouer, j’avais négligé beaucoup de petits détails, ce qui faisait capoter le grand projet.
Le plus désagréable dans la captivité, ce furent les premiers mois. A cette période- là, je connus des cellules de prison pour la plupart petites, dans lesquelles j’étais seul, abandonné à mes pensées et mes sentiments. Je découvris alors l’immense détresse de telles cellules de prisonniers et la seule pensée que des millions d’êtres humains avaient surmonté de telles périodes et que le temps de ma captivité ne durerait pas éternellement, m’aida à supporter l’anéantissement. L’impuissance et l’impossibilité de pouvoir d’ici aider ma patrie opprimée, dans cette lutte des peuples, fut la deuxième goutte amère ajoute à ma coupe de souffrance. Mais tout ça ne servait à rien. Je devais compter avec ces faits et voir comment je pouvais surmonter cette période sans devenir fou ou idiot. C’est pourquoi je mis sur pied un emploi du temps, j’observai l’évolution des rayons du soleil, qui tombaient dans ma cellule par la fenêtre du haut et je me fis ainsi un cadran solaire. C’est comme ça que passaient les heures. Et puis je mettais mes tables et mes chaises les unes au- dessus des autres et grimpais jusqu’à la fenêtre, pour profiter de l’air frais et porter mes regards au loin, vers le ciel bleu. La nuit, j’observais des heures durant, les étoiles au firmament.
Mes vêtements avaient été déchirés bien des fois au cours de ma marche vers le front. Mon gardien de cellule me fournit aiguille et fil et je raccommodai des heures durant, les parties de mes vêtements abimées, ce dont je m’acquittai même avec une certaine habileté.
Au cours des premières semaines de ma captivité, je fus soumis à de nombreux interrogatoires et à toutes tentatives inimaginables, de la part de mes surveillants, d’apprendre de moi des nouvelles sur nos troupes, des précisions sur notre façon de nous organiser etc… Mais mes enquêteurs comprirent bientôt qu’ils ne tireraient rien de moi au cours de ces interrogatoires officiels. Ils ont ensuite essayé en utilisant tous les moyens possibles. Je ne peux naturellement pas savoir s’il y avait plus d’un ou deux espions parmi les nombreux prisonniers allemands, avec lesquels je pouvais partager chaque jour l’air frais, dans une cour étroite. En tout cas, je me suis aperçu deux fois que les deux officiers apparemment allemands qui étaient enfermés avec moi dans la cour, n’étaient que des espions français en uniforme allemand. Il n’est pas besoin de préciser que j’ai essayé de les tromper et que je leur ai menti aussi scrupuleusement que lors de mes premiers interrogatoires.
La captivité ne fut supportable que le jour où j’arrivai au camp de prisonniers pour officiers de Montoire.
Tentatives d’évasion malheureuses
Deux cent cinquante officiers allemands et 80 ordonnances étaient enfermés là-bas dans un espace vraiment petit. Comme moi j’étais capitaine, j’avais toute proportion gardée pas mal de place et étais content de mon sort. Les quinze premiers jours, je passai mon temps à me reposer des différentes prisons, dans lesquelles on m’avait trainé. Au bout de quinze jours à être allongé au grand air sous le beau soleil de juillet, j’en avais tellement assez de cette tranquillité que je commençai, à partir de ce moment-là, à travailler aux différentes possibilités d’une évasion. Les projets les plus divers furent évalués et rejetés.
L’un deux était de parvenir à une des cours environnantes par un grand trou, que nous avions fait dans le toit de la maison d’hébergement. Mais une tuile du toit tomba, cela attira l’attention du gardien trop tôt et il nous fallut battre en retraite avant l’aube.
Une autre fois, il s’agissait de passer à travers les barbelés et la clôture. Après un long et prudent travail, après maintes ruses et malices, nous avions trouvé une possibilité de nous faufiler. Nous étions trois. Au crépuscule, tandis que les autres prisonniers se trouvaient encore dans la cour, nous commençâmes à ramper. Il fallait que le lieutenant Sand écarte encore quelques barbelés avec des ciseaux et il venait de terminer. Il avait déjà atteint la rangée externe des barbelés, près de laquelle on devait enjamber un chemin de ronde. Un deuxième suivait et j’étais le troisième. Nous voyions déjà le premier d’entre nous au bord d’une petite rivière qui coupait le camp du monde extérieur, en plus des barbelés. Cette rivière, nous voulions la traverser ensuite à la nage. A cet instant, le garde s’approcha du chemin de ronde et nous découvrit tous les deux dans les barbelés. Il fit naturellement tout de suite un bruit infernal et nous fit prisonniers, alors que nous étions encore bloqués dans les barbelés. Comme nous étions deux, il ne put en arrêter qu’un. Moi, Je m’échappai et retournai au camp. Comme il faisait sombre, j’avais l’espoir de ne pas être reconnu par le garde, qui ne put pas me voir de près et ne m’avait encore pas vu souvent. Naturellement, mes vêtements avaient été bien déchirés par les barbelés. Je passai toute la nuit à les remettre en état, afin que, le matin suivant, lors de l’appel, ils ne me trahissent pas. Le lendemain matin, le garde ne me repéra pas et crut reconnaître le fuyard dans un autre. Celui -ci écopa aussitôt d’un mois de peine de prison à cause de ma tentative de fuite. Lorsque, plus tard, je me fis connaître au commandant du camp comme étant celui qu’on cherchait, j’allai en prison aussi à la place de l’autre. Mais douze jours après, on ouvrit la porte et on me signifia que j’étais libre et que je pouvais sortir.
Comme je l’appris plus tard, le supérieur du commandant du camp n’avait pas cru mes déclarations conformes à la vérité, car elles s’opposaient aux déclarations officielles du soldat français. C’est pourquoi je devais m’estimer content de ne pas être enfermé à côté de l’innocent, accusé à cause de mon mensonge.
Une autre fois, nous avions creusé durant des semaines un très long tunnel qui partait d’une des baraquements. Quand le tunnel fut prêt et qu’on put s’en extraire la nuit et envisager de sortir du camp, on rassembla tout ce qui pouvait servir à l’évasion. Le soir du jour qui précédait l’évasion, les membres de la surveillance, qui firent un appel par surprise, découvrirent tout le projet, ils confisquèrent toutes les belles provisions et enfermèrent un mois en prison, tous ceux qui étaient suspects et avaient trahi leur participation imprudemment ,d’une manière ou d’une autre. Moi, j’eus la chance de leur échapper et on me donna le chocolat entassé parmi les provisions destinées à l’évasion.
Une autre tentative d’évasion à deux devait avoir lieu par le moyen le plus proche, c’est à dire passer par-dessus le mur avec une échelle, que l’allumeur de lampes utilisait chaque jour. J’étais le deuxième. Mon partenaire avait déjà grimpé sur le mur et j’étais sur le point d’accéder à l’échelle, pour monter sur le mur et ensuite retirer l’échelle, quand un coup partit de l’autre côté du mur. Mon camarade était tombé entre les mains d’un garde inconnu de nous, posté derrière le mur. Il ne me fut pas difficile de faire marche arrière et de revenir au camp, sans me faire repérer. Là aussi je récupérai le chocolat à manger alors que mon camarade dut effectuer le quota de prison prévu.
Il m’apparut très clairement à ce moment là qu’une tentative d’évasion ne pouvait avoir une issue heureuse que si elle était entreprise seul et que personne du camp n’en avait connaissance.
Un laps de temps considérable s’était écoulé durant toutes ces tentatives d’évasion vaines. Entre temps, on était arrivé au 9/11/1918. L’espoir de rentrer bientôt au pays disparaissait de jour en jour et l’ambiance, en ces tristes journées d’hiver, était pire qu’avant.
L’évasion
Alors, c’est avec le printemps qui venait que surgirent de nouveaux projets d’évasion, seul cette fois. Seuls les gens dont j’avais besoin de la protection pour mon projet furent informés. Mes camarades de chambre n’en surent rien.
C’est un beau soir de pleine lune, en septembre 1919 que sonna l’heure de l’évasion. J’avais tout préparé jusque dans les moindres détails.
Peu de temps après le départ de chez moi de l’officier de garde, qui chaque soir devait parcourir les lieux d’hébergement individuels avec l’interprète, je me mis à l’œuvre. Ma chambre était au premier étage. A côté, il y avait d’autres petites pièces, dans lesquelles seulement deux hommes étaient hébergés. Avant, j’avais préparé deux couvertures dans l’une des pièces et dès que l’officier eut quitté la partie du camp où nous étions, je me rendis dans la pièce la plus proche, j’attachai vite deux couvertures ensemble et demandai aux occupants de la pièce de me tenir les couvertures. Je me jetai par- dessus la balustrade de la fenêtre et me laissai glisser le long des couvertures jusqu’à la cour, qui était ouverte. Là- bas, j’attendis derrière un buisson que l’officier ait traversé la cour pour se rendre dans les autres pièces d’habitation. Je marchai derrière lui avec insolence en direction du poste de garde principal. En ce moment tous les gardiens étaient partis de sorte qu’on ne pouvait guère en trouver. Au vu de tous les gardiens, j’allai ensuite dans une étable, qui jouxtait le bâtiment de garde, j’y trouvai un balai avec un très long manche et grimpai dans le coin à la gouttière, pour aller dans la cour la plus proche en passant par le toit de l’étable. Ce n’était pas aussi facile de grimper là-haut que je me l’étais imaginé. Je m’appuyai sur le manche du balai et atteignis avec peine l’un des derniers crochets auquel je m’agrippai pour monter. Pendant que j’étais là-haut, en bas, les gardes passaient les uns après les autres. Mais comme je l’avais observé auparavant, ils ne regardaient pas dans ce coin, mais vers l’intérieur du camp. Enfin, le dernier garde passa au- dessous de moi avec l’officier chargé de tout vérifier, avec l’interprète et le garde chargé de fermer.
J’eus une chance incroyable qu’ils ne me voient pas.
Après avoir attendu sur le toit que plus rien de suspect ne bouge, qui puisse conduire à découvrir ma fuite, je me rendis dans le jardin contigu, de la même manière que j’étais monté là- haut. Avec toute la prudence possible, je me mis à l’œuvre. D’abord, je constatai que la maison dans le jardin de laquelle je me trouvais, n’était pas habitée. Le propriétaire était manifestement encore en vacances au bord de la mer. Une porte qui conduisait à la place du marché était fermée. Je regardai autour de moi et cherchai une solution pour sortir du jardin, peut être en escaladant les toits des maisons voisines. Mais c’était plus dangereux que de se diriger vers la place du marché. Je cachai le balai dans un hangar à voitures, dans lequel je trouvai quelques caisses. Je rangeai mon uniforme dans l’une de ces caisses aux parois de planches minces et m’habillai en civil. J’avais deux sortes de pantalons, un costume lustré, une veste de civil et une veste kaki, mon uniforme et une casquette de sport que je m’étais fabriquée moi- même. Je mis ce dont je n’avais pas besoin dans la caisse.
La seule possibilité de sortir de ma cachette sans me faire remarquer était de franchir la porte qui barrait le passage. Pour cela, il me fallait la casser. La moitié de la petite ville de Montoire était rassemblée sur la place du marché. En face du passage, il y avait un petit théâtre, un guignol devant lequel une foule de gens était assise et qui était précisément en train de jouer une pièce apparemment assez drôle. J’attendis quelques minutes à la porte, j’avais déjà constaté qu’il serait possible, en usant de violence, de l’arracher. A ce moment- là, on entendit soudain deux voitures qui brinquebalaient sur la chaussée déformée. L’une d’elles était déjà passée et l’autre arrivait. Il me sembla que ce fracas était tout à fait propre à couvrir le bruit occasionné par la destruction de la porte. Donc, j’arrachai la porte et sortis sur la place du marché, en marchant à côté de la voiture qui roulait. Je marchai au milieu de la rue avec ma caisse sur le dos et sortis de Montoire. J’avais la possibilité de me déplacer en me cachant, mais je me serais sûrement davantage fait repérer et aurais éveillé plus de soupçons qu’au milieu de la rue. Je n’évitai pas du tout, les gens, mais je marmonnai des choses pour moi. Il n’est pas venu à l’idée des gens que j’étais un officier allemand prisonnier du camp, sinon ils m’auraient poursuivi. C’est ainsi que je sortis de la petite ville, dans laquelle se trouvait notre camp de prisonniers.
En route vers la frontière
Avec ma caisse, je continuai à avancer jusqu’au prochain village, où un pont enjambait la Loire (le Loir : erreur dans le texte !). Je me fis un baluchon de mon habit d’officier. Je jetai ma casquette dans la rivière et la regardai s’éloigner.
Après avoir laissé derrière moi ce petit village et constaté que rien ne bougeait et qu’on n’entendait aucun bruit, je m’assis d’abord derrière une haie au bord du chemin et me reposai. Je dois dire que j’étais pas mal excité et que le cœur me battait de tous ces derniers événements. La lune était dans le ciel et j’avais vraiment oublié, quelle était ma direction. En avion, j’aurais qualifié cet état « d’égaré ». Mais ici, j’avais le temps, de rester assis tout le temps qu’il fallait pour savoir exactement dans quelle direction je devais aller. Dix minutes après, tout me parut de nouveau clair. Je voyais l’étoile polaire, voyais la lune se déplacer vers l’ouest, j’avais ainsi la direction dans laquelle se trouvait mon pays, l’est, et je continuai à marcher toute la nuit dans cette direction. C’était une merveilleuse nuit de pleine lune, aussi belle que les plus belles nuits que j’aie jamais vécues en tant qu’aviateur.
C’était calme et désert dans toute la contrée. Je traversai des villages et des fermes, des chiens surgissaient et leurs aboiements m’accompagnaient dans ma progression. C’est ainsi que j’arrivai à la route qui croisait la direction d’où je venais et conduisait de Vendôme à Tours. Je m’allongeai d’abord derrière un épais buisson au bord du chemin, pour attendre le matin. Malgré mon intense fatigue, je ne dormis pas longtemps. J’avais peur que mes ronflements attirent l’attention des gens qui passaient. Le matin arriva et j’ai rarement vu dans ma vie un aussi beau lever de soleil. Tout le ciel à l’est, du nord au sud, n’était qu’une boule rose, qui chassait devant elle, vers l’ouest, la nuit d’argent bleutée.
Avant que le soleil ne surgisse comme une mer de feu étincelante, les premiers habitants, tels des pèlerins, longèrent la route. J’avais abandonné mon plan, de traverser les régions détruites et de gagner directement la Hollande. Joyeux et heureux de ma nouvelle liberté, je choisis un bel itinéraire pour mon voyage. Je n’avais encore jamais vu le sud de la France et la Suisse et je dirigeai mes pas vers ces lieux. Je marchai d’abord dans la direction opposée à celle où se trouvait ma patrie et me retrouvai plus tard sur les bords d’un canal. Le premier jour, j’ai failli mourir de soif dans les hauteurs que j’avais à traverser, sous une canicule affreuse, sans eau. Je n’osais pas aller dans les maisons demander de l’eau et je ne pouvais en trouver que dans des puits très profonds. Je marchai ainsi pendant quatre jours. La nuit, je dormais dans les forêts et dans les champs, le jour je continuais ma route. Souvent, je courais le danger d’être découvert, la plupart du temps parce que je ne maîtrisais pas la langue du pays, en partie aussi parce que j’essayais de m’acheter des bricoles dans les villes.
Contrôle des papiers
Lors de mon périple, j’avais étudié dans les différentes gares comment faire pour prendre un billet et je m’étais entrainé à repérer les trains, si bien que l’après- midi du quatrième jour, je pus essayer de poursuivre mon chemin par le moyen de transport plus rapide, c’est à dire, le chemin de fer. A Blois, je m’achetai pour la première fois un billet pour Bourges. Dans le compartiment, je me joignis à une famille et arrivai ainsi tout à fait bien à mon but. De là, le lendemain matin, après une nuit affreuse à Bourges, où j’avais failli être découvert par un garde, je pris un billet pour Lyon. Le soir de ce même jour, j’avais étudié toutes les possibilités de voyage jusqu’à la frontière suisse et m’étais à nouveau acheté un billet pour Annemasse, sans me faire reconnaître.
Je ne pouvais naturellement prendre des billets que pour les destinations dont je pouvais à peu près prononcer les noms. Le trajet entre Lyon et la frontière suisse fut pour moi assez dangereux. On m’interpela de différentes manières sans que je puisse répondre aux questions. Chaque fois, je me déplaçai dans un autre compartiment du train. Au cours du trajet vers Bellegarde, il me fallut compter avec un contrôle de papiers. En écoutant les conversations des gens, je perçus qu’il devait y avoir un contrôle près de Bellegarde. En fait, j’avais l’intention de descendre avant, mais quand je regardai par la fenêtre, je vis que le chemin passait entre d’étroits rochers et qu’il n’était sûrement pas possible de quitter le train sans montrer le billet et sans entrer en contact avec des gens. Finalement, j’arrivai à Bellegarde. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour réfléchir et voir si je pouvais me cacher dans le train, sous le train ou sur le train. Le train était entouré de douaniers, de policiers avec des chiens et il n’était pas possible de rester plus longtemps dans le train. Je ne savais pas non plus si le train allait en Suisse, après avoir passé la frontière. J’étais presque le dernier à quitter le train et il ne me restait plus qu’à suivre le flot des gens. En empruntant un souterrain, nous parvinrent à une grande salle d’attente, dans laquelle on avait mis une palissade en bois de telle sorte que tous les gens devaient avancer les uns derrière les autres et le contrôle des papiers avait lieu à l’extrémité de ce passage. La- bas, il y avait trois policiers qui regardaient les passeports de tous ceux qui passaient. Je n’avais pas de passeport. Il y avait plusieurs paysannes devant moi, qui tendaient leurs papiers comme il faut et les tenaient à la main. Je voyais ces passeports et je souhaitais en avoir un, moi aussi. Si je n’en avais pas avant d’arriver devant les policiers, c’en était fait de moi.
Le jour précédent, je m’étais acheté un journal pour 5 centimes en tendant l’argent au vendeur de journaux et en prenant le journal sans parler. Dans ce journal, il y avait en bas une annonce et cette annonce présentait une similitude avec le texte et le format du passeport, que les paysannes avaient à la main.
Je pliai le journal de sorte qu’on ne pouvait voir que l’annonce et mis mon billet à l’endroit où se trouvait la photo, sur le passeport. Pour un inspecteur pas très attentif, ça ressemblait vraiment à un passeport. Je me glissai alors entre les paysannes. Ma tenue vestimentaire pouvait aisément faire croire que j’étais l’un des leurs. Les policiers arrivèrent. L’un d’eux se tenait d‘un côté et les deux autres étaient de l’autre côté, l’un derrière l’autre. Ils examinèrent tous les passeports. Les femmes étaient juste en train de montrer les leurs. J’avais mon passeport dans la main droite, je regardais l’un des policiers et tendais le passeport au suivant. Quand je passai devant le premier, je tendis le passeport au premier et regardai le deuxième et j’avais passé le contrôle. J’étais moi-même un peu surpris de cette issue. J’avais déjà envisagé de me faire passer pour sourd et muet, pour avoir, au cas où, l’occasion de m’échapper pendant le transport au poste de police ou en prison. Après cette réussite, j’étais d’ailleurs devenu très confiant. Je passai tout aussi bien le barrage où avait lieu le contrôle des billets.
Passage de la frontière
A Bellegarde, je traversai un pont qui était surveillé par un militaire. Je ne savais pas s’il était nécessaire de montrer ses papiers ou pas. En tout cas, je passai aussi ce pont, en fonçant sur le garde et l’obligeant à s’écarter pour m’éviter. Comme il faisait sombre et qu’il pleuvait, je ne savais pas par où continuer mon chemin. Je n’avais, pour l’instant, pas la possibilité de m’orienter avec les points cardinaux. C’est pourquoi je laissai passer une journée. Ensuite, je progressai en direction de la frontière, après quelques incidents similaires au contrôle des passeports. Il me fallut presque toute la journée pour effectuer les quelque 20 kms qu’il me restait à parcourir. Quand vint le soir, j’arrivai tout près de la frontière constituée à cet endroit par le Rhône. Un orage violent s’était déclaré, une pluie épaisse tombait et il faisait nuit noire. Donc je pus m’approcher de la frontière sans me faire remarquer et eus l’avantage et l’énorme chance qu’aucun garde ne soit dehors par cette tempête. Je traversai des localités, que je ne pouvais reconnaître que grâce à la lumière des éclairs qui jaillissaient. Arrivé au bord du Rhône, je déposai mes quelques provisions et tout ce qui n’était pas absolument nécessaire et je voulus d’abord essayer de traverser le Rhône à la nage. Lors de cette tentative, je fus entrainé dans le fleuve par les flots violents. Le mieux était d’essayer d’atteindre l’autre rive. Il m’était presque impossible de nager. J’ai failli mourir dans les flots, car le petit baluchon que je m’étais attaché sur la tête, poussait ma tête dans l’eau. C’est seulement après avoir arraché le baluchon de ma tête que je pus atteindre l’autre rive, en le tirant à côté de moi. Une fois arrivé, je me rendis à la gendarmerie et de là, le lendemain, on me conduisit au consulat général d’Allemagne. La joie que j’éprouvais après cette évasion réussie ne pouvait pas être plus grande que la joie qui nous remplissait quand nous nous réveillâmes sur Greenly Island après un profond sommeil, le lendemain de l’atterrissage.